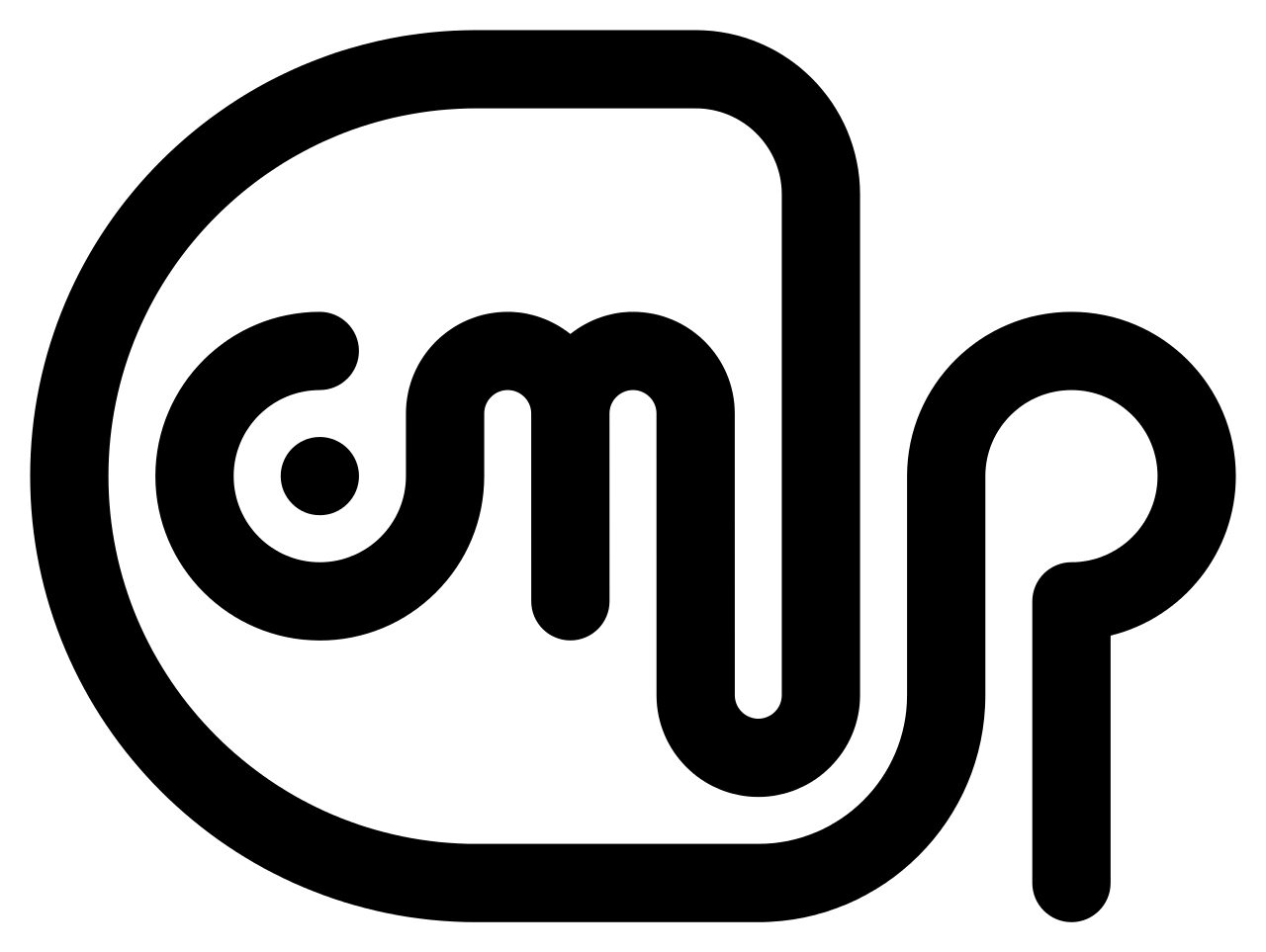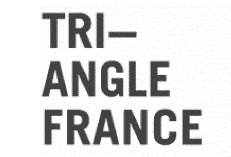Conversation avec Rosa Joly

Le travail de Rosa Joly ne cesse d’interroger les conditions de sa propre apparition. À commencer par le lieu même de production que représente l’atelier. Prenant comme point de départ l’incertitude quant au désir d’inscription de l’art dans la durée, elle déconstruit le processus autoritaire inhérent à la conservation des œuvres par le développement d’une économie d’actions et de partages refusant tout attachement à la pérennité au profit d’une vision davantage brève et par là-même autant politique que poétique. Pour se faire, elle initie des rencontres matérielles dont l’efficacité visuelle rivalise avec l’instabilité telle que le report à grande échelle du hall d’entrée d’un immeuble Hambourgeois de la Hansaplatz donnant accès à une maison close située à l’étage (Minnie Town, 2015) sur des pans entiers de soie à l’aide de bâtons de pastel gras ou encore le modelage d’une structure autoportante en plâtre et en aluminium - forme libre de prélèvement d’un échantillon du réel et/ou consolidation d’un interstice réfléchissant à la fois l’environnement immédiat mais transposant d’autre part l’héritage underground de la Factory new-yorkaise dans l’enceinte des résidences de Triangle - Astérides à la Friche la Belle de Mai (Shield, 2021). Quel est donc le statut de ce support à projection mentale transhistorique ? L’artiste procède par l’intermédiaire de la sculpture, de la photographie (à travers la technique du cyanotype), du film, de la vidéo et même du texte au recensement émotionnel de ses espaces de travail et de vie. Elle leur fait subir l’épreuve du déplacement géographique afin de reconstituer dans l’exposition un climat émotionnel dans lequel les marqueurs du lieu initial se retrouvent flottants - tel un western saloon vidé de ses affects. Ainsi, sa production constitue une véritable cartographie unipersonnelle à travers laquelle elle rend hommage à certaines villes telles que Marseille, Hambourg, Lyon, Berlin, Paris, Los Angeles ou encore New York mais aussi et ceci de manière plus micro-locale à des lieux où « chambres » façonnées par les amitiés initiées en ces lieux. Par conséquent, Rosa Joly nous invite à découvrir le partage mais surtout le don comme nouvelle matérialité de l’œuvre. Il est convoqué ici pour ses qualités d’action volontaire mais aussi en tant que forme d’invitation à l’abandon ou encore sous forme d’invitation tacite à s’en remettre aux soins de quelqu’un·e d’autre.

ARLÈNE BERCELIOT COURTIN Ton travail apparaît souvent comme la forme plastique d’un hommage à d’autres artistes que ce soit par la marque d’un attachement à un titre et/ou à un protocole réflexif particulier. Je pense notamment à Matt Mullican mais surtout à Jutta Koether. Ainsi, lors de la préparation de cet entretien, nous avons évoqué l’œuvre séminale de Jutta Koether The Inside Job (1991) pour laquelle elle décide de déconstruire à la fois la sémantique de l’atelier mais aussi de la peinture comme véritable machine à discours sur l’art. À ce sujet, elle confie dans un entretien avec le critique d’art Benjamin Buchloh : « BB: But your response to painting was not necessarily to resurrect it. Was there no attempt to redeem painting? JK: Yes and no. Redeeming was certainly not on my agenda. I never looked at painting as some masterful thing one would want to reinstall, but instead as a platform, a potential, an island, a lifeboat, a discipline to negotiate life... a performance. An attempt at something impossible, a reinvention of painting through painting. I wanted to make it a temporary site, which I took literally. There was this large painting I made in 1992 called Inside Job. It was a work that I made in New York before I showed in a gallery. I placed the painting in an apartment on the floor and invited people to view it. »1Peux-tu nous dire en quoi ces deux artistes ont influencé ton regard sur l’art ?


ROSA JOLY Un peu comme Jutta Koether au moment où elle met en oeuvre The Inside Job j’envisage mes installations comme des lieux sociaux. Autrement dit en tant que sites pour la sociabilité. C’est ce qui se trouve au cœur de ma première exposition monographique : paris a scenario for a silent movie (2016) dont le titre est emprunté à un poème de Piero Heliczer. À cette occasion, j'ai exposé pour la première fois une danse macabre, inspirée de la Totentanz de la Marienkirche (1463) qui fut détruite lors du bombardement de Lübeck par la Royal Air Force le 29 mars 1942. La chapelle de la Totentanz (aussi appelée : Totentanz Kapelle), a été réduite à néant. Dans ce bombardement la danse macabre peinte par Bernt Notke a disparue. Ce chef d’oeuvre, dont nous ne possédons aujourd’hui que des photographies en noir et blanc, ornait les murs d’une chapelle qui abritait l’orgue de la danse macabre : un orgue historique sur lequel a joué Jean-Sébastien Bach, ainsi que le plus vieux drapeau au monde qui était un drapeau danois. L’exposition paris a scenario for a silent movie chez Pauline Perplexe à Arcueil est une sorte de mise à jour de cette peinture disparue, sauf que les squelettes - qui sont initialement les maillons de la chaîne macabre - sont devenus de très grands cyanotypes sur papier, et les portraits de notables et de villageois sont les portraits de mes ami·e·s - tous·te·s artistes vivant à Paris. À travers cette œuvre, je convoque une forme de résurrection et/ou d’hommage à une peinture détruite mais surtout je réalise le portrait du milieu et/ou de la scène artistique au sein de laquelle j’expose et dont certains membres m’ont servi de modèles. Ceux-ci se sont prêtés à des séances de pose assez longues, au cours desquelles il y a du gossip, des confidences plus profondes, une sieste, une session d’ordinateur…

J’aime aussi beaucoup revoir les photos du vernissage où le corps des visiteur·se·s (d’autres artistes et/ou curateur·rice·s - prinipalement des personnages lié·e·s au milieu artistique) apparaissent devant cette grande fresque et démultiplient l’effet farandole. Parfois aussi, i·elles se prennent en photo à côté de leurs doubles de papier… Ces photos que je ne montre pas forcément font cependant partie de l’oeuvre et me sont très chères, car comme souvent dans mon travail le temps s’indétermine, se superpose voire se collapse. Ainsi, cette mise en oeuvre très spontanée m’a amenée à réaliser quelques jours avant l’exposition les portraits à la craie grasse qui seront par la suite entièrement tendus vers le moment où la matière encore vivante des dessins va continuer d’être animée par la présence corporelle et sociale du public, lors du vernissage d’une part, puis pendant toute la durée de l’exposition.
Depuis j’ai trouvé d’autres tricks, en fabriquant des miroirs que je dissémine dans le lieu d’exposition pour capter cette énergie motrice apportée par le corps des spectateurs·rice·s, pour que l’oeuvre elle-même se trouve enrichie de la vie qui la traverse. Chez Jutta Koether c’est plutôt le carnet qui enregistre le passage des visiteur·se·s, c’est lui qui se nourrit des commentaires des acteur·rice·s du milieu de l’art tels que rapportés par l’artiste, mais aussi de sa propre vie et de ses interactions avec la ville de New York, des expositions qu’elle va voir, des objets qu’elle rencontre en faisant du lèche-vitrine et/ou en visitant une brocante… L’oeuvre est un centre à partir duquel des lignes sont lancées avec l’espoir que quelque-chose va surgir à la surface, encore frétillant de vie, immortalisé en trois lignes et/ou coups de craie grasse…
Cette spontanéité dans la tentative de capturer une série d’instants, de révéler une intimité, une fantaisie, de rendre manifeste des rapports de pouvoir, est aussi une manière de lutter contre l’aspect parfois écrasant de « l’œuvre » qui apparaît en un seul bloc, qui s’érige comme le produit d’un·e seul·e individu·e un peu génie et/ou génial – qui (si possible) va au passage un peu écraser les copains/copines pour apparaître comme l’« unique »… Une autre manière pour moi de lutter contre cet effacement de l’emprunt et de l’inspiration d'un être par un autre est de toujours citer très précisément ma famille artistique, qu’elle soit vivante et/ou de ma génération et/ou plus ancienne mais non moins agissante. Dans l’exposition chez Pauline Perplexe à Arcueil il y avait, posé sur un banc, un exemplaire de The Tide Inside, une nouvelle que j’ai écrite et auto-publiée. Celle-ci concentre et condense les notions que je viens d’évoquer. À savoir : la citation, l’hommage, la destruction/réanimation et dans ce cas presque le bouche à bouche… La nouvelle (The Tide Inside, 2015) met en présence Jay DeFeo et Marthe Bonnard, fameuse baigneuse (et femme du peintre que l’on connaît) dans une scène de baignade en méditerranée directement empruntée à l’unique roman de l’écrivaine américaine Jane Bowles (Two Serious Ladies, 1943). Chez Jane Bowles, la scène se passe au Panama (et donc dans l’océan pacifique) entre une prostituée du nom de Pacifica et une Américaine en voyage de noce. Ma nouvelle construit de son côté un récit dont l’apex est cette scène de baignade, puis redescends vers une issue anti-climatique… En épigraphe de cette nouvelle - déjà bien peuplée de références, de personnages contre-employés et de personnalités ayant existés - se trouve un poème d’HD issu du recueil The walls do not fall (1944), écrit pendant le Blitz à Londres et qui commence par ces lignes : « There is a spell, for instance, in every seashell ». Je la trouve magnifique. Elle compare ici, le crustacé à un « maçon de génie »… Il me semble que c’est un peu cela, au sens propre et au figuré, la question de l’inside et du milieu. C’est finalement comment on investit/se construit une maison pour abriter notre corps un peu mou, un peu vulnérable… Nous avons tous·te·s des briques un peu différentes, des affects, une éducation ou pas, des amours littéraires, télévisuels, cinématographiques, musicaux, des paysages… Qui d’une certaine manière nous sauvent en nous permettant de nous sentir en commun·ion avec un·e autre qui semble penser et aimer comme nous (ou très différemment, avec la nature aussi)… C’est donc la question de cette carapace qui crée un lieu à partir duquel nous pouvons choisir ou non de laisser entrer l’autre, avec les conséquences que cela peut avoir pour soi-même… Mes installations, sont souvent des projections à l’extérieur de cet espace intérieur. Un espace que j’essaie de structurer en créant des enceintes et/ou des obstacles qui divisent l’espace et s’imposent aux corps, comme pour les inclure à mon projet de transmission (d’un affect, d’une référence, etc.).

ABC Cela me fait penser à ce que tu m’avais confié à propos de Sylvia Plath et ton expérience de lecture de son roman intitulé The Bell Jar publié sous le pseudonyme Victoria Lucas quelques mois avant son suicide. Dans ce roman, elle décrit une scène avec une boîte d’allumettes négligemment laissée par son docteur - cela me conduit à ton œuvre (Rat Bastard aka Sleeping Child, 2017) qui est à la fois une référence/hommage à Sylvia Plath mais aussi au travail de sculpture de Matt Mullican. Peux-tu nous en dire davantage ? J’en profite pour remarquer que ton intérêt se porte souvent sur des autrices de poésie et/ou de nouvelles qui ont essayé l’exercice du roman – je pense ici à Sylvia Plath bien sûr mais aussi à Janes Bowles qui a inspiré ta propre expérience du texte dans l’espace de l’exposition (paris a scenario for a silent movie), et de manière plus contemporaine à Eileen Myles. En quoi l’interrelation entre poésie et fiction inspire ton propre travail ?
RJ J’ai lu The Bell Jar il y a très longtemps, quand j’étais encore étudiante à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon. Je ne me souviens plus vraiment de ce qui m’y a amené… En tout cas, cela a été un choc ! Tout d’abord, ce roman puis la poésie de Sylvia Plath que j’ai découvert juste après… Dans The Bell Jar, il y a ce passage que j’adore et qui est à l’origine des premières allumettes géantes que j’ai réalisées quand j'étais étudiante en France et qui n'étaient pas des objets fonctionnels mais de « vraies » sculptures ! Il y a ce passage dans le livre où l’héroïne est laissée seule dans le bureau d’un psychiatre qui vient de la recevoir. Après son départ, elle se dirige vers la fenêtre et voit une petite boîte d’allumettes posée là. Elle décide alors de l’ouvrir et découvre que la tête soufrée de ces allumettes est rose. Elle pense alors qu’elles ont peut-être été placées là - intentionnellement - pour étudier sa réaction… J’ai trouvé très drôle cet aveu de paranoïa. Et, aussi la liberté que l’héroïne prend en manipulant cet objet dans un bureau qui n’est pas le sien (j’ai relu le passage et elle décide finalement de voler la boite d’allumettes)… J’aime la complexité des émotions éveillées par cet objet anodin et j’ai aussi une image visuelle très forte de cette petite boite en pleine lumière, de la tête rose des allumettes qui se révèle - c’est une très belle image.
« After Doctor Nolan had gone, I found a box of matches on the windowsill. It wasn’t an ordinary-size box, but an extremely tiny box. I opened it and exposed a row of little white sticks with pink tips. I tried to light one, and it crumpled in my hand. I couldn’t think why Doctor Nolan would have left me such a stupid thing. Perhaps he wanted to see if I would give it back. Carefully I stored the toy matches in the hem of my new wool bathrobe. If Doctor Nolan asked me for the matches, I would say I thought they were made of candy and had eaten them. »
Sylvia Plath, The Bell Jar, 1963

Aussi, lorsque j’étais étudiante auprès de Matt Mullican à la Hochschule Für Bildende Künste de Hambourg j’ai exposé le premier prototype effectif d’une allumette fonctionnelle - plus grande que nature - une sorte de « prop » à l’air un peu grotesque jusqu’au moment où sa tête est frottée sur un grattoir géant lui aussi. Alors, cette tête un peu maladroite s’enflamme… Je me souviens que Matt avait beaucoup aimé cette « sculpture-prop ». Plus tard, lorsqu’il a été invité par François Piron pour un séminaire à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, je suis intervenue à propos de mes recherches sur la scène californienne des années 1950 et j’ai activé un exemplaire d’allumette géante comme point final de mon intervention. Ce jour-là, j’ai parlé de l’œuvre de Jay DeFeo et de la scène artistique de la baie de San Francisco. J’ai notamment évoqué les assemblages réalisés par les artistes de cette communauté à l’époque, en particulier ceux de Bruce Conner. Ce fut pour moi l’occasion d’interroger Matt Mullican, à propos de sa relation à la scène nord-californienne - lui étant de L.A et à fortiori beaucoup plus jeune que les protagonistes sur lesquels j’écrivais alors. Nous avons également évoqué ensemble Sleeping Child (1973/2014), une œuvre qui a été très importante pour moi et qui est un élément fidèle de ses installations. En effet, je la trouve à la fois très simple (un morceau de bois dont l'une des extrémités repose sur un oreiller) mais au-delà de cette considération, je la trouve surtout magnifique. Je suis particulièrement touchée par sa simplicité d’exécution et sa capacité à provoquer l’empathie…


Ce rapport presque animiste aux objets du quotidiens - si usuels qu’ils en deviennent invisibles… C’est exactement ce que Georges Pérec nomme l’Infra Ordinaire (1989) dans son texte du même nom. C’est pour moi l’essence même du poétique et donc de l’art, c’est ce qui me touche chez une autrice très importante pour moi ces dernières années et que j’ai découverte à mon avis beaucoup plus tard que je ne l’aurais dû. Il s’agit de Violette Leduc, qui parle aux paillettes prisonnières du sol en béton du métro parisien, qui porte un petit renard en fourrure trouvé dans les poubelles, jamais très loin de l’ordure et du sublime. Et surtout elle écrit les plus belles pages sur la solitude et la compagnie des objets.
« J’amènerai le coeur de chaque chose à la surface. Je me redresserai, je revivrai. Puisque je suis morte pour les autres, à mon tour je les abandonnerai. Chaque fois que je contemple la boîte sur ma table, je reçois d’elle une leçon de stoïcisme. Le stoïcisme de chaque chose n’est pas contradiction intérieure, mais plutôt abandon rentré. Si j’allais en prison, je me reserrerai comme une chose. Chaque chose est contemplation rentrée. Il y a dans ce monde-là, comme dans celui des statues, un narcissisme à l’étouffée. Les choses qu’on ne remue pas sont des déserts moelleux. (...) J’ai déposé la boîte sur mon divan. Je me suis allongée à côté d’elle. Il n’y a plus besoin d’un fil conducteur. Nous avons dégagé, nous avons échangé le coeur de notre coeur. »
Violette Leduc, L’affamée, 1948
ABC Régulièrement dans tes recherches, deux noms s’entremêlent au profit du processus créatif. C’est le cas par exemple pour tes films : The Eye, The Asshole, My Sister (2019), The New Wounded (2015), ou encore Elbemini (2011). Ainsi, je voulais partager avec toi la tentative de définition de la collaboration publiée dans l’ouvrage The Hundreds co-écrit par les autrices américaines Lauren Berlant et Kathleen Stewart. Et notamment lorsqu’elles précisent que: « In any collaborative relation there is a fear of deep checking in. What do we do in the event of the force of clashing taste? It might turn out that we were falling through ice after all, not making tracks in the same- enough way. Some collaborators seek a secure job as the referent. The mind threatens to grow into an insane place if it’s not getting to feel how it was supposed to feel. Some collaborators demand that everything confirms the circuits of their enjoyment. (...) So we look for points of precision where something is happening. We don’t presume what’s going on in a scene but look around at what might be. We tap into the genres of the middle: récit, prose poem, thought experiment, the description of a built moment as in The Arcades, the Perecian exercise, fictocriticism, captions, punctums, catalogs, autopoetic zips, flashed scenes, word counts. » Comment pourrais-tu définir ce désir de collaboration ? En quoi est-il fondamental dans ta manière de produire de l’art ?
RJ C’est en quelque sorte un prolongement de ce que je viens d’évoquer. De ce qui peut sembler prendre la forme d’un hommage (lorsqu’il s’agit d’un·e artiste plus expérimenté·e et/ou d’une figure historique) mais qui s’apparente presque à un appropriation de certains aspects des oeuvres que j’admire et qui m’inspirent. En effet, la fascination que certaines oeuvres produisent sur moi est un moteur pour prolonger, transposer, interpréter et parfois même contrarier l’intention initiale de l’artiste et/ou auteur·rice que je convoque. En essayant de décrire ce qui pourrait parfois presque prendre le nom de « possession », je pense au poète Jack Spicer et à After Lorca (1957), un recueil constitué de faux poèmes de Lorca et de lettres d’outre-tombe du poète espagnol (mais évidemment écrites par Spicer lui-même). C’est un hommage et c’est aussi un exercice de style puisque le pastiche en littérature, tout comme le travail de faussaire en peinture, nécessite quelques talents ! Et, si comme dans le cas de Spicer le pasticheur est aussi un des plus grands auteurs… La figure de Lorca est un moteur pour Spicer qui s’amuse à retrouver la téciture de la voix de ce poète qu’il admire. C’est à la fois beau et tendrement irrévérencieux, fondamentalement sérieux et aussi très drôle…
« Frankly I was quite surprised when Mr. Spicer asked me to write an introduction to this volume. My reaction to the manuscript he sent me (and to the series of letter that are now part of it) was and is fundamentally unsympathetic. It seems to me the waste of a considerable talent on something which is not worth doing. However, I have been removed from all contact with poetry for the last twenty years. The younger generation of poets may view with pleasure Mr. Spicer’s execution of what seems to me a difficult and unrewarding task. It must be made clear at the start that these poems are not translations. In even the most literal of them Mr. Spicer seems to derive pleasure in inserting or substituting one or two words which completely change the mood and ofter the meaning of the poem as I had written it. More often he takes one of my poems and adjoins to half of it another half of his own, giving rather the effect of an unwilling centaur. (Modesty forbids me to speculate which end of the animal is mine). »
Préface de Jack Spicer / Federico García Lorca à After Lorca (1957)

RJ Pour revenir à ta question - qui je crois concernait plutôt un type de travail en commun et donc plus ancré dans le présent entre deux individus vivants et consentants - j’aime travailler en tout petit comité, souvent dans des relations one to one, avec certaines de mes amies artistes et notamment lors de la réalisation de films. Si je reprends les films que tu as évoqués : la matière visuelle d’Elbemini par exemple est issue d’un tournage réalisé avec Daiga Grantina. D’autre part, The New Wounded (2015) a été tourné avec Julie Gufler. Et enfin mon dernier film intitulé The Eye, The Asshole, My Sister (2019) est le résultat d’un travail d’une année avec Anaëlle Vanel. Chaque tournage provoque une intensification de ma relation à chacune de ces autrices. Ainsi, la volonté de se rencontrer d’une part et de vouloir abandonner son identité pour se fondre à l’autre d’autre part produit des sortes de petits miracles. Comme des instants de grâce passagers que le film est en mesure de capter puisque sa fonction première est bien l’enregistrement de ce que nous croyons voir mais il s’agit au final de bien plus. C’est drôle maintenant que j’y réfléchis - chacune de ces autrices développe une pratique très éloignée de la mienne et elles sont incomparables les unes aux autres. À l’époque où j’ai rencontré Daiga elle tournait des films en 8mm, Julie est écrivaine et Ananëlle photographe. Travailler avec elles, fut essentiel à la construction de mon identité d’autrice. Et j’ai adoré sortir de la solitude - parfois un peu pesante - de l’atelier pour laisser court à un travail dont l’issue nous échapperait nécessairement aux unes et aux autres… Se laisser aller ainsi n’est possible que dans un climat de totale confiance et le fait que nous soyons toujours amies et que notre amitié ait même été renforcée par ces tournages est - à mon avis - la preuve que l’inspiration était mutuelle et que chacune y a trouvé son compte !
ABC 3. Nous venons de le voir, le film - mais aussi bien souvent l’objet physique de la pellicule - tient une place privilégiée dans ton travail. En quoi ce médium s’est imposé comme principal ? Parmi tes références cinématographiques, nous avons évoqué à plusieurs reprises le cinéma d’avant-garde qu’il soit européen et/ou américain.Je pense notamment à Chantal Akerman dont nous avons évoqué à plusieurs reprises le film Je, Tu Il, Elle (1974) et sa dimension autobiographique, mais aussi à La Bande des Quatre de Jacques Rivette et son rapport au théâtre et à l’improvisation, ou encore le cinéma de Kenneth Anger qui t’a profondément marqué et dont nous retrouvons un certain érotisme dans ton traitement de l’image pour Elbemini (2011) ? En quoi ton travail partage cette même croyance en l’image ?
RJ Le rapport entre image en mouvement et croyance… C’est une belle question ! Et quitte à répondre un peu à côté je dirais que pour moi les films ont le pouvoir de changer ma vie, d’en infléchir profondément le cours… Ce sont des objets très puissants. Chez Kenneth Anger par exemple, c’est très clair : ce sont des rituels auxquels il donne corps, qui suivent une partition précise, une chorégraphie d’autant plus agissante qu’elle est invisible…
Pour ce qui est de mon travail, je dirais qu’il y a deux aspects qui cohabitent.
Premièrement, la cinéphilie (ce que je regarde et qui m’inspire) et deuxièmement ma pratique du cinéma expérimental. Si j’opère cette distinction en te répondant, si je mets d’un côté l’aspect « consommateur » (presque addict) de la cinéphilie et de l’autre, la réalisation de mes films, c’est justement pour souligner que l’un mène à l’autre, que certains films me mettent le pied à l’étrier et vont ouvrir un nouvel horizon… Pour te donner un exemple : j’ai découvert l’oeuvre de Jay DeFeo au Ludwig Museum à Cologne en visionnant The White Rose (1967) dans lequel Bruce Conner filme l’extraction de la fameuse peinture monumentale de l’artiste américaine intitulée : The Rose. Ce film fut donc le point de départ d’une recherche sur Jay DeFeo qui dure maintenant depuis plus de dix ans. Aujourd’hui encore son oeuvre me précoccupe, puisqu’elle est au coeur de mon prochain projet de film qui sera exposé lors de la première exposition européenne consacrée à l’oeuvre photographique encore méconnue de Jay DeFeo programmée par la Maison Européenne de la Photographie en 2023. Par ailleurs, Bruce Conner et ses films Looking for Mushrooms (1967) ou encore Cosmic Ray (1969), Vivian (1965), sans oublier Crossroads (1976) sont des influences essentielles. Pour ce qui est de la filmographie de Chantal Akerman. C’est après avoir regardé News From Home que mon amie Anaëlle Vanel et moi-même avons commencé à sortir la nuit et à nous planter au coin des rues pour filmer notre quartier… À l’époque nous vivions à Berlin vers Kurfürstenstrasse. Si contrairement à New York, Berlin est une ville qui dort, ce quartier est justement animé la nuit - du fait de la présence des prostituées, de leurs clients, et de leurs macs aussi… Le lieu et le moment sont très différents de ce que Chantal Akerman filme dans News From Home, même si dans son cas comme dans le nôtre - il y avait l’envie de filmer un pays étranger la nuit, de planter son trépied et d’attendre… Donc oui, la dimension autobiographique chez Chantal Akerman, la présence de son corps même lorsqu’il est hors-champ. L’émotion qui se dégage malgré l’apparente objectivité de son cadrage très frontal… J’aime vraiment tout ce que j’ai vu d’elle. À commencer par Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975), en passant par les Rendez-vous d’Anna (1978) et jusqu’à Un Divan à New York (1996)…

Dans son long-métrage Je, tu, il, elle (1974) que tu évoques plus tôt et dont nous avons parlé à plusieurs reprises, le corps de Chantal Akerman est présent tout du long. Dès le début lorsque nous la voyons voit manger du sucre à pleines cuillères - à même le sac d’1kg - jusqu’à la fin lorsqu’elle se filme en train de faire l’amour à une jeune femme blonde qu’elle est venue retrouver en faisant du stop. Tout ce que j’ai vu de Chantal Akerman je l’ai aimé - donc je pourrais en parler très longtemps - mais je préfère
peut-être finir en revenant à News from Home en disant que c’est très beau de les
imaginer, elle et Babette Mangolte, sillonner les rues de Manhattan la nuit. Pour moi aussi les tournages sont une manière de lier amitié et travail avec certaines de mes amies, lorsqu’elles veulent bien se prêter à ce jeu…
ABC 4. Nous avons évoqué la place importante réservée à l’atelier come lieu de travail, l’approche collaborative de tes films, l’interrelation entre l’amitié et le cinéma d’avant-garde, mais il nous faut également aborder la dimension de la recherche inhérent à ton travail artistique. Je pense spécialement à la californienne Jay DeFeo autour de laquelle tu as mené un travail profond dans le cadre de ton doctorat de recherche en art. Comment s’est construite cette proximité avec son œuvre ? Lors de nos échanges, nous avons souvent évoqué The Rose (1958-1966) résultat de plus de sept années de travail sans relâche pendant lesquelles l’américaine va recouvrir sans cesse la même toile d’une large épaisseur de peinture transformant ainsi un simple tissu en véritable bas-relief voire sculpture à fortiori statique en raison de son poids d’une part mais aussi de la fragilité de l’exercice. À travers ce geste, nous pouvons apercevoir une rupture voire un satyre de la planéité de la peinture expressionniste américaine d’après-guerre mais aussi la critique d’une approche quelque peu masculiniste de ce médium. En effet, Jay DeFeo fait partie des trois artistes femmes invitées à exposer dans le néanmoins célèbre show « Sixteen Americans » au Museum of Modern Art de New York. Et, même si elle accepte de participer à cette exposition, elle ne fera pas le déplacement pour le vernissage et refuse même de présenter The Rose alors en début de processus. Comment l’approche politique de Jay DeFeo dialogue-t-elle avec ta production artistique ?
RJ Si le travail de Jay DeFeo est politique c’est peut-être justement à travers cette non-compromission qui l’a amenée à se consacrer au moment où sa carrière était en train de décoller - suite à l’exposition de Dorothy Miller au MoMa - à réaliser sa vision et à la laisser se développer hors des proportions spatio-temporelles «normales». La peinture monumentale The Rose (1958-1966) qu’elle refuse d’inclure dans l’exposition “Sixteen Americans” du MoMA et que l’on va tenter de lui acheter à plusieurs reprises au cours des années suivantes devient en ce sens un point d’ancrage. Une sorte d’étendard pour la communauté d’artistes et de poètes gravitant autour du numéro 2322 de la Fillmore Street à San Francisco. Plutôt que de devenir l’exception qui s’extrait d’une communauté artistique pour récolter les fruits collectifs d’une scène particulièrement riche (où les échanges interdisciplinaires sont la règle) Jay DeFeo s’ancre plus solidement encore au centre de cette scène. Ainsi, en faisant ce qui s’apparente de prime abord à une sensation de « sur place » elle en anime le centre. Parfois, en regardant sa trajectoire et en rapprochant ce moment crucial pour sa carrière (pendant lequel elle décide de ne pas aller à New York et même de ne pas répondre aux galeries qui la sollicitent) je suis tentée de penser qu’il s’agit là d’un auto-sabotage et/ou de la peur de prendre trop la lumière… Mais The Rose est justement tout sauf une œuvre craintive et/ou modeste. C’est plutôt la mise en acte d’une croyance profonde. C’est aussi la création d’une sorte de scène au sens de « stage » sur laquelle défilent les curateur·rice·s, les artistes, les poète·sse·s qui lui rendent visite… Certain·e·s de ces visiteur·se·s du 2322 Fillmore Street ont d’ailleurs parlé d’une chapelle au centre de laquelle s’érigeait la peinture concentrique (elle était effectivement placée au centre de la Bay Window de l’atelier - par ailleurs sans lumière électrique). À l’instar du projet intitulé The Inside Job de Jutta Koether, la réalisation de The Rose participe à la création d’un site (voire d’un mythe), ces deux artistes créent la possibilité d’un “ici et maintenant” inamovible qui attire vers elle les curieu·x·s·es en tous genre… Cela se fait de manière bien sûr très différente mais des deux côtés, nous retrouvons la peinture comme un espace réflexif à déconstruire. Le contexte par contre est très différent, puisque Jay Defeo va ainsi passer presque huit ans (1958-1966) à réaliser cette peinture aussi monstrueuse que performative.

ABC 5. Parmi les géographies de ta recherche, les États-Unis, la Californie et plus particulièrement la baie de San Francisco tiennent une place particulière. Tu t’apprêtes d’ailleurs à retourner dans les archives de Jay DeFeo grâce à l’obtention de plusieurs bourses de recherche (Convention Ville de Nantes/Institut Français, Aide Individuelle à la création de la Drac Loire Atlantique). Comment ce territoire artistique intéragit avec ton travail ? Quels sont les documents auxquels tu souhaites avoir accès ? Les États-Unis possèdent une politique de conservation très différente de la France et de l’Europe, en quoi cela facilite et/ou complexifie ta manière de travailler sur place ?
RJ Ce voyage à venir - qui a longtemps été repoussé du fait de la pandémie et de la fermeture des frontières américaines - sera ma troisième visite à la Jay DeFeo Foundation. Lors de ma première visite (octobre 2017), j’ai découvert un corpus quasi inconnu de l’oeuvre de DeFeo. Un véritable continent photographique dont je n’avais aucune idée et qui reste encore aujourd’hui en grande majorité totalement inédit. Lors du second voyage (Juillet 2018), la Fondation Jay DeFeo m’a généreusement accompagnée. Ainsi, j’ai pu passer deux semaines à Berkeley afin de consulter l’ensemble des planches-contacts. J’ai aussi au accès aux sublimes tirages réalisés par l’artiste au début des années 1970. Sans rentrer davantage dans les détails, ce corpus est composé de vanités virulentes et de fantômes chimiques, d’objets usés à la corde capturés dans leur survivance - envers et contre tout… En restant vague mais tout de même un peu énigmatique (surtout pour ne pas gâcher l’effet de la magnifique exposition qui se prépare à la Maison Européenne de la Photographie à Paris), j’aimerai dire à quel point ce travail photographique a influencé mon travail ces dernières années. Je souhaite aussi exprimer mon impatience et mon enthousiasme à l’idée de retourner à Berkeley pour filmer une sélection de ces tirages avec ma caméra 16mm… Je peux aussi peut-être rapidement restituer le contexte dans lequel ces photographiess ont été réalisées au début des années 1970. Après l’aventure de The Rose, un divorce (elle était alors mariée avec l’artiste Wally Hedrick), l’expulsion de son atelier de Fillmore Street ainsi que l’exposition du tableau à Pasadena en 1968 puis son stockage au San Francisco Art Institute (où l’oeuvre restera plus de vingt ans), Jay DeFeo a cessé de produire de l’art pendant presque quatre ans au cours desquels elle fréquente un groupe de jeunes gens déserteurs de la guerre du Vietnam. Ils écumaient alors les festivals de Rock (plutôt nombreux à San Francisco à la fin des années 1960). Ses photographies - qui seront la matière première de mon film - ont été prise au moment où elle se remet au travail et assemble les morceaux d’une vie passée. Elle documente ainsi des oeuvres sauvées de son déménagement, des photographies de ses dents tombées les unes après les autres - du fait d’une exposition prolongée au plomb contenu dans la peinture blanche utilisée pour donner corps à The Rose… Aujourd’hui, mon souhait est de filmer de manière frontale certains tirages issus de ce retour à la vie de l’atelier – un peu comme un hommage que j’aimerais comparable à The Wormwood Star de Curtis Harrington (1956) dans lequel apparaissent des dessins de l’occultiste Marjorie Cameron. Ou encore à l’image de The man we wan to hang (2002) de Kenneth Anger dans lequel il filme une exposition des peintures d’Aleister Crowley…

RJ D’ailleurs, je suis ravie de partager avec toi des vues d’installation de l’exposition à laquelle je participe actuellement à Berlin dans le nouveau lieu fondé par Sebastian Wiegand en octobre 2021. À cette occasion, j’ai initié un duo de sculptures en plâtre et en aluminium, selon la technique que tu évoques au début de notre échange, et l’une d’entre elle - porte justement le nom: “The Wormwood Star”, en référence au film… Il me semble que nous tenons ici la fin d’une boucle…