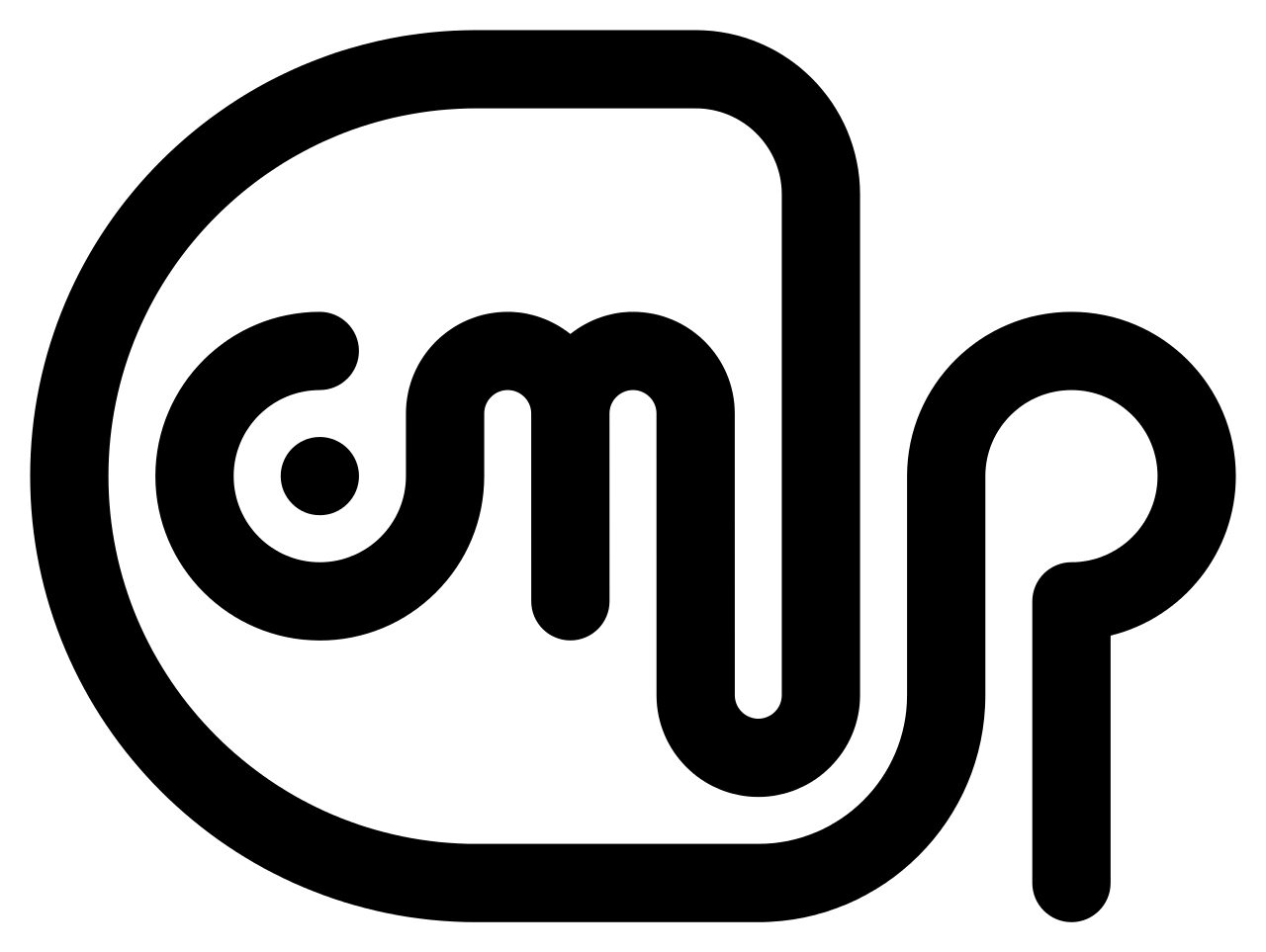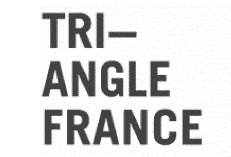Entretien avec Karima El Karmoudi
L'artiste Karima El Karmoudi inaugure le premier cycle de programmation proposé sur BRUISE magazine, intitulé « Archives, narrations et pratiques collectives », et revient sur sa pratique et les recherches menées lors de sa résidence à Triangle-Astérides entre septembre et décembre 2022. Des dessins réalisés par ses parents et reproduits sur des tapis aux enjeux d'une langue orale dans la transmission d'histoires, cet entretien évoque les systèmes D mis en place pour contourner des situations subies, le travail à six mains, les richesses de l'incompréhension et des méthodologies d'archivages furtives.
Camille Ramanana Rahary (chargée des résidences et ateliers, responsable des éditions à Triangle-Astérides) : Ton travail s’inscrit à l’intersection des trois notions qui constituent ce premier cycle abordé dans Bruise Magazine : celle des pratiques collectives, des archives et des différentes formes de narrations. Il y a d’ailleurs dans une partie de ta production, cette méthodologie de la pratique collective. Dans l’exposition de Jagna Ciuchta « Le pli du ventre cosmique » organisée en 2021 à Bétonsalon et à laquelle tu as été invitée à participer, deux prénoms, Allal et Fadma, apparaissaient aux côtés du tien. Au-delà de l’affiche qu’ils partageaient avec toi, c’est aussi le même nom de famille qui vous réunissait. Dans le journal de l’exposition on apprend qu’il s’agit de tes deux parents, qui, au même titre que toi et les autres artistes exposé·es, bénéficient de notices. Celles-ci mentionnent notamment une collaboration à six mains, initiée en 2018. Jusqu’alors, les œuvres que tu avais produites référaient à des expériences d’enfance que tu n’avais pas vécues, au temps qui passe et affecte les matériaux et les souvenirs (Pâte à sel façon Tadelakt, 2012), ou à un imaginaire colonial que tu inventoriais méticuleusement notamment en récoltant des pages de magazines. Comment ce travail à trois est-il apparu ?

Karima El Karmoudi : Le dessin, et tout particulièrement le travail mené avec mes parents, a commencé il y a 4 ou 5 ans, lorsque j’étais étudiante en deuxième année à la Villa Arson, et que je réfléchissais aux notions de transmission orale et de souvenir. Mes parents me racontaient beaucoup d’histoires mythologiques, allant des combats d’animaux aux sorcières. Il y avait tellement de récits qu’ils commençaient à se mélanger dans mon esprit qui se remplissait de souvenirs perdus, et de contes qui me berçaient depuis l’enfance. J’ai ressenti le besoin et l’envie de pouvoir avoir accès à toutes ces histoires autrement qu’oralement, même si notre langue, le tamazight, ne se transmet que de cette façon. Pour cette raison, il était impossible les adapter à l’écrit, et je n’avais de toute façon pas envie de transcrire ces histoires en français car je voulais conserver toutes leurs spécificités, sans en perdre une partie à la traduction. Une fois ces constats faits, il nous restait une solution : le dessin. Un soir, alors qu’iels me racontaient des histoires, j’ai demandé à mes parents de me faire un dessin. Leur première réaction a été de me dire qu’ils ne savaient pas dessiner, mais ils se sont rapidement prêtés au jeu. Un protocole assez naturel s’est alors mis en place : tous les jours, pendant un an et demi, ils dessineraient. Certains des dessins étaient faits par mon père ou ma mère uniquement, d’autres par les deux ensemble. Il m’arrivait également d’intervenir, mais plus rarement. Les dessins représentaient des fragments d’histoires, et ce médium était aussi pour moi une manière d’archiver toutes ces histoires. Même s’il m’arrive de ne pas être en mesure de deviner l’histoire représentée sur un dessin, cela ne me dérange pas. Je suis davantage intéressée par le fait de créer un corpus composé de ces milliers d’histoires qui m’ont été contées à l’oral.

CRR : Le passage a l’écrit suppose une perte inévitable de la richesse de l’oralité et de ses « spécificités » comme tu les appelles. Il en est de même pour la traduction qui malgré sa capacité de transmission et de diffusion élargie d’une information, ne peut contourner la perte d’un mot qui n’aurait d’équivalent dans une autre langue, ou d’une expression purement idiomatique. Dans le cadre de ton travail, le dessin devient une alternative à la double perte qu’impliquent la traduction et la transcription. Les formes, les couleurs se substituent au rythme, au ton et à la voix propres à l’oral. Tout comme une histoire ne saurait être narrée de la même manière par des personnes différentes, les traits, ou encore les motifs invoqués et les couleurs utilisées varient selon qu’il s’agisse de ton père ou ta mère, et le dessin permet de retrouver une forme de singularité dans une narration qui n’est plus linéaire. Cet abandon de la trame narrative montre bien qu’à travers la collecte de tous ces dessins, tu ne cherches pas une retranscription fidèle de ce qui t’a été rapporté oralement. C’est une approche particulière de la transmission : tu assumes le manque, l’incompréhension, et l’incapacité d’interpréter fidèlement ce qui a été représenté. La question du sens est d’ailleurs au cœur de l’un de tes films (Caparo, 2019), dans lequel tu prends le parti de ne rien traduire, de ne rien sous-titrer et de laisser à chacun·e le soin de développer sa propre interprétation de ce qui est vu, à travers les images, ou perçu à travers les intonations. Comme dans les dessins de tes parents, les mots manquent. Comment concilies-tu la volonté de transmettre des histoires, et ce goût pour ce qui ne serait pas directement compréhensible ?
KEK : Les histoires comme celle évoquée dans Caparo ont plusieurs strates. Elles peuvent être drôles, comme profondément tristes. Mais toutes parlent de situations qui sont importantes à mes yeux. Encore une fois, je ne voulais pas traduire littéralement l’histoire racontée dans le film, même si, d’une certaine manière c’est ce que j’ai fait en la mettant en image. Mon processus a été de décortiquer toute l’histoire que mon père raconte en me demandant quels étaient les mots clés, les mots importants. Je suis en suite allée sur internet pour chercher des images qui pouvaient représenter les différentes étapes de l’histoire, à la manière d’un rébus. Et comme tu le dis, les manques, les incompréhensions, les trous me conviennent très bien, et je cherche même à en jouer. La nature des images que je sélectionne n’a pas d’importance pour moi : il peut s’agir d’images très pixelisées trouvées sur internet, comme de captures d’écrans, de photos issues de banques d’images ou de mon téléphone. Pour moi, l’important n’est pas de savoir d’où provient cette image mais plutôt de savoir ce qu’elle dit. Pour cette raison, j’essaye, selon les histoires, de les traduire avec des médiums complètement différents.

Dans le cas de Caparo, je n’avais aucune envie d’ajouter des sous-titres parce que je ne voulais pas que les personnes qui regardent la vidéo puissent avoir une compréhension totale de l’histoire, de son début à sa fin. Ce qui m’intéresse davantage, c’est l’idée que le public expérimente une situation d’incompréhension, à l’instar des personnes qui ne parlent pas la langue du pays dans lequel elles se trouvent : si je vais en Allemagne et que j’allume la télévision, je ne vais rien comprendre, mais je vais me concentrer sur les images et essayer de me faire ma propre interprétation de ce qui est montré, même si elle ne sera pas forcément exacte. Il y aura des trous, des incompréhensions, mais c’est le jeu. J’ai également rencontré cette problématique lorsque j’ai travaillé sur l’analphabétisation et la manière d’évoluer dans des environnements tels que les magasins. Comment fait-on pour faire ses courses lorsqu’on ne sait pas lire un chiffre, et donc un prix ? Bien sûr certains systèmes se mettent en place, mais ce sont des systèmes D, car il n’y a pas le choix de faire autrement.
CRR : Il arrive même qu’à partir de situations d’incompréhension qui pourraient sembler incommodantes, tu réussisses à créer du dialogue. Je pense notamment aux visites d’ateliers que tu as menées lors de ta résidence à Triangle-Astérides et qui étaient destinées des élèves allophones, dont certain·es ne parlaient pas un mot de français. Comment as-tu réussi à « contourner », pour reprendre tes termes, la barrière de la langue, et à créer ce rapport d’égalité face à la langue parlée ou non, et à te faire comprendre tout en ouvrant un espace de parole et d’échange pour chacun·e là où l’on aurait pu penser le dialogue tout bonnement impossible ?
KEK : Ces rencontres avec les étudiant·es allophones furent réellement enrichissantes. Elles étaient d’ailleurs assez simples. Je leur ai montré la vidéo Caparo en annonçant en préambule qu’il n’y avait pas de traduction et que s’iels ne comprenaient rien, c’était normal parce qu’elle était tamazight. Je leur ai proposé de regarder les images de tirer à partir d’elles leur propre interprétation de l’histoire. C’était génial de pouvoir discuter ensemble de ce qui avait été retenu, car finalement, en accumulant les bribes de chacun·e, on arrivait à reconstituer ce qui était racontée dans la vidéo. Même si certaines choses n’avaient pas été comprises, l’essence de l’histoire, elle, l’était. Après le visionnage de la vidéo, je me suis rendue compte que la question de la précarité avait de suite été comprise, de même que la question de la souffrance, des rapports de pouvoir.

Un peu plus tard pendant la visite, je leur ai montré les dessins de mes parents ainsi que les tapis que j’étais en train de faire. La parole était très peu présente, mais elle était simplement là pour appuyer les visuels que j’étais en train de leur montrer, qui étaient eux beaucoup plus parlants que des paroles. L’enjeu était de trouver un équilibre entre le fait de ne pas discuter des pièces mais simplement de laisser place aux images qui sont tout aussi parlantes, et qui en disent beaucoup plus que des mots. Cette rencontre m’a permis de modifier mon curseur de discussion, et m’a appris à ne pas épiloguer sur certains éléments car de toute façon personne n’aurait tout saisi. Créer des liens entre les dessins sur papier et ceux représentés sur les tapis a facilité la compréhension de mon travail, et je suis convaincue qu’une prise de parole de ma part pendant une demie heure n’aurait servi à rien.
CRR : D’une certaine manière, ces atelier sont venus confirmer ton intuition première : l’écriture et la traduction ne sont pas nécessaires à la compréhension d’une histoire. En revanche, la libre interprétation des situations, en partie faite à partir des expériences personnelles et des références de chacun·e, a permis de convoquer un imaginaire commun, et de déboucher sur une compréhension globale d’une histoire initialement inconnue de tous·tes. En d’autres termes et pour reprendre l’exemple de Caparo, si personne n’a la même façon de dire ou de nommer la précarité, l’expérience commune d’une telle situation suffit à rassembler et à créer une signification qui dépasse les mots. Cette façon de contourner la langue, qu’elle soit orale ou écrite, suppose dès lors de puiser dans sa vie personnelle des éléments qui permettraient de donner un sens à ce qui est donné à voir ou à entendre.
KEK : Pendant ces rencontres, on a discuté de la possibilité de compréhension, et de système D. On a évoqué le personnage de Caparo et les stratégies qu’il avait pu mettre en place pour contourner la situation de survie à laquelle il faisait face. Plus largement, nous nous sommes demandé·es comment, dans nos vies respectives, on faisait lorsqu’on ne comprenait pas quelque chose. Les étudiant·es ont évoqué leurs difficultés, comme celles en jeu lorsque’il s’agit de prendre un train, et de trouver un bon quai par exemple. Nous étions réuni·es autour de problématiques communes. Personnellement, je suis née en France et je parle français, mais mes parents font partie de la première génération à être arrivée en France, et cette question de l’incompréhension due au fait de ne pas parler un langage commun est très présente dans ma vie et dans ma famille. Je suis donc habituée à trouver des systèmes D. Lorsque j’étais au collège, je passais du temps dans des Taxiphone, et il m’arrivait souvent d’écrire des lettres ou de lire des lettres à des gens qui venaient et qui ne savaient pas parler français. C’est pour ça que je m’intéresse aussi à la figure passionnante de l’écrivain·e public·que. Certain·es enfants sont écrivain·es public·ques dès leur plus jeune âge, parce qu’iels n’ont pas le choix de faire autrement. Lorsque tu vas chez le médecin et que tes parents ne parlent pas français, c’est toi qui es là pour faire la traduction, et par la force des choses tu prends la casquette de l'écrivain·e public·que.
CRR : Comme le personnage de ton film Caparo s’accommode des lois et s’en sort grâce à la débrouille, ta pratique se base sur une stratégie du contournement, qui permet d’échapper à des situations sur lesquelles tu n’aurais pas prise. Elle consiste aussi à trouver des alternatives pour pallier les difficultés imposées par certains systèmes, notamment celui de l’écriture.
KEK : Le système D est une notion très importante dans mon travail et dans ma vie en règle générale. Je cherche des méthodes pour contourner des systèmes déjà établis, que cela soit dans la vie courante ou dans ma pratique artistique. Je reste à ce jour très inspirée par une image qui pourrait sembler anodine, mais qui m’avait beaucoup marquée. Un jour, le carreau d’une fenêtre de ma maison s’est cassé, et pendant longtemps un carton a été placé de manière provisoire pour calfeutrer le tout, puis une première couche de scotch de couleur, puis, une seconde de scotch à motif. J’ai trouvé toutes ces stratégies pour chercher à cacher provisoirement quelque chose très belles. Il y avait-là une esthétique du système D qui m’a beaucoup parlée, et touchée, dans sa capacité à contourner et proposer une solution alternative. J’ai également retrouvé des stratégies de système D à l’occasion du court métrage sur lequel j’ai travaillé à la Maison d’arrêt de Nice, où j’ai pu me rendre compte de combien le système D était important pour les prisonniers, qui en font un mode de vie : pour récupérer de la nourriture, pour cuisiner, etc.
CRR : Tu évoquais un peu plus tôt le tapis, médium que tu as beaucoup travaillé lors de ta résidence à Triangle-Astérides. Dans ton atelier, les pelotes de laine colorées remplissaient les étagères alors que tu t’attelais à reproduire à l’aide de ton tufting gun les dessins réalisés par tes parents. Comment en es-tu arrivée à ce médium, et pourquoi avoir décidé de reproduire des dessins qui existaient déjà sur papier ?

KEK : Ma mère pratique le crochet de manière régulière depuis plusieurs années. On avait d’ailleurs fait un projet ensemble, en même temps que celui des dessins de mes parents. J’avais exposé plusieurs de ses coussins crochetés fabriqués spécialement pour mon diplôme. Et de la même manière que pour le projet des dessins, ma mère a commencé le crochet par des souvenirs d’enfance. Elle s’est ensuite rendue sur Youtube, a regardé de nombreux tutoriels qui lui ont permis de gagner en technicité. C’est aussi de cette manière que nous avons découvert le tufting. Ma mère a tout de suite eu envie d’apprendre à en faire, et c’est comme ça que ça a commencé.
Ces dernières années, je me suis trouvée face à la question de la monstration des mes œuvres, et de celle des dessins de mes parents, sans jamais trouver une solution qui me semblait assez juste. J’ai essayé de trouver un moyen d’archiver ces dessins, de trouver un moyen de les protéger dans l’espace d’exposition, mais qui permette en même temps leur consultation. Pour moi, il n’y a rien de pire dans une exposition que d’être face à un livre ouvert à une certaine page, et de ne pas pouvoir tourner les autres, et savoir ce qui se cacher derrière. Bien sûr, il ne faut pas abîmer les archives, mais j’essaye de contourner la chose pour trouver un autre moyen de les montrer. J’avais d’ailleurs découvert à Bétonsalon le travail de Babi Badalov qui avait utilisé des portes-vues noirs comme méthode d’archivage. Ils étaient posés sur des supports en bois, de manière à ce qu’on puisse librement les feuilleter. On y retrouvait à la fois des papiers administratifs relatifs à sa demande de nationalisation, et des prospectus, des collages, des choses trouvées par terre. À ce moment là je me suis dit : « c’est ça ! ». Il a réussi à trouver un moyen de mettre en image son archive pour que les gens puissent la consulter sans frustration, et créant un lien direct entre soi et l’archive, sans intermédiaire entre les deux. Plus tard, je me suis rendue compte que si je n’arrivais pas à montrer comme je le voulais les dessins de mes parents, c’est parce que j’y étais sentimentalement trop attachée. J’avais peur de les abîmer, de les manipuler. Je faisais des photocopies pour essayer de ne pas les altérer, mais je sentais bien que je n’y mettais pas vraiment une part de moi dedans.
CRR : Et c’est comme ça que tu en es venue au tapis…
KEK : En regardant de nouveau les dessins, qui racontent tous des bribes d’histoires, j’ai eu envie de les reproduire par le biais du textile, et plus particulièrement du tufting. Pour un projet que j’avais mené lorsque j’étudiais à la Villa Arson, j’avais pris en photo la devanture d’un centre esthétique marocain nommé « Henna Paint ». Ce qui m’intéressait sur ce mur n’était pas le nom du centre écrit en toutes lettres, mais bien plus les dessins de mains et de pieds ornés de henné, dont les traits donnaient des informations sur le lieu. Il y avait une double traduction qui permettait à tout un chacun, sachant lire, ou non, de décoder la nature de ce centre. J’avais décalqué ce dessin, et l’avait transpercé avec une aiguille très fine et de la feutrine, de sorte à remplir la trame de mon tissu en reproduisant fidèlement les couleurs.

Cependant, cette technique s’est révélée très chronophage et j’ai fini par la laisser de côté donc j’ai laissé ça de côté, en gardant toutefois en tête les couleurs et les textures que je venais de créer. Il a fallu un certain temps avant de comprendre que la suite logique de ces travaux de recherche était de reproduire les dessins de mes parents sur du textile et le médium du tapis. D’un côté je disposais d’un tufting gun, et de l’autre je collectionnais ces centaines de dessins réalisés par mes parents. J’avais pris assez de recul sur ces derniers pour m’en détacher et les traiter objectivement comme des dessins, pour leurs traits et leurs couleurs, et non plus comme des objets à haute valeur sentimentale uniquement.
CRR : Je me souviens t’avoir rendu visite à l’atelier, et te voir hésiter entre plusieurs pelotes pour choisir les teintes les plus proches des dessins que tu reproduisais. Tu voulais absolument que le tapis soit fidèle au dessin, et ne t’autorisais aucune modification personnelle.
KEK : J’ai décidé de sélectionner certains dessins car ils me plaisaient picturalement, pour en faire des tapis. À la manière d’une faussaire, j’avais envie de reproduire les dessins avec exactitude, en prenant autant en compte la précision des traits que leur fragilité, ainsi que les couleurs vives pleinement assumées par ma mère et mon père. Le médium du tapis m’intéresse également dans toute la dimension traditionnelle qu’il convoque, notamment à travers l’héritage des tapis berbères, l’artisanat qui les entoure, et les histoires que l’on raconte à travers eux. Aujourd’hui, je fais des tapis avec un outil contemporain, tout en ne perdant pas une certaine forme d’artisanat. Transformer les dessins sur papier en tapis m’a également permis de changer leur échelle, et de les faire sortir de leur format initial grâce à mon travail d’exécutante. C’est encore un travail en cours. Il y a aussi autre chose que j’aime mettre en forme dans tout mon travail : le faux-semblant. Le projet Pâte à sel façon Tadelakt, 2012 est un faux mur aux allures de crépis. J’aime jouer avec les histoires, avec ce qui est vrai, faux, et ce qui se situe à l’interstice des deux. C’est d’ailleurs le cas de mes tapis. Je trouverais ça génial de pouvoir les vendre comme des tapis ayant été faits par une communauté berbère d’un certain pays, raconter leur fabrication traditionnelle, alors que c’est moi qui les ai créés avec une machine. Le tapis me permet également d’aborder la question du commerce, et questionne l’achat à des prix dérisoires de ces objets par les occidentaux·ales, puis leur exportation et leur revente à des prix indécents.

CRR : J’aimerais partager avec toi une lecture qui fait très justement écho à ce que tu viens d’évoquer. Dans un article sur les objets du tourisme, la chercheuse Corinne Cauvin-Verner aborde la question des tapis berbère et de leur commercialisation. Elle s’attarde entre autres sur les questions d’authenticité et de tradition et développe la thèse selon laquelle « ce que le tourisme invoque n’est que fabrication ». Selon elle, « l’émotion des visiteurs ne naît pas du tapis en lui-même, de sa beauté, de sa rareté ou de son ancienneté, mais de la mise en spectacle de sa production ». J’aimerais poursuivre en te citant un passage de son article, qui traite plus particulièrement des coopératives de tissage existantes au Maroc : « visitant la coopérative, les touristes ont le sentiment de contribuer au maintien de techniques archaïques et à la survie matérielle de femmes démunies. Ils regardent attentivement les gestes de l’ouvrière, photographient le métier et les peignes, palpent la laine… Pleins d’émerveillement condescendant devant ce tableau qui fait de toutes les femmes des gardiennes de la tradition et des tisseuses en puissance, le temps d’une visite, ils sont ethnographes. Le motif de leur voyage, qui cumulait des prétentions culturelles et humanitaires, s’en trouve satisfait ». Il me semble qu’on retrouve-là cette idée de faux-semblant, d’histoire créée de toute pièce, n’hésitant pas à se jouer de clichés. Tu t’intéresses à cette notion de mise en scène d’une esthétique factice simplement créée pour satisfaire le regard et l’imaginaire occidental et colonial. Tu avais déjà montré double-pages de magazines que tu collectionnes, représentant des femmes allongées à la posture lascive, reprenant les codes de la peinture orientaliste et particulièrement la figure de l’odalisque. Lors de ta résidence à Marseille, tu es allée au-delà de ces représentations, et tu en as profité pour arpenter les cafés arabes de la ville, dont les décors consistent pour la plupart en de véritables lieux de fictions, où les propriétaires jouent le jeu du dépaysement, de l’exotisme, n’hésitant pas à reproduire des esthétiques factices, mais qui, dans l’imaginaire occidental, semblent authentiques…
KEK : Le tourisme invoque des fabrications. Mes pages de magazines mettaient en avant le fait que de nombreuses marques de mode rejouaient les tableaux orientalistes, sans que cela ne pose de problème à personne, alors même que ces représentations ni justes, ni normales mais simplement racistes et choquantes. Pourtant, c’est ce que les gens semblent vouloir pour être satisfait·es : iels s’imaginent à Marrakech croiser des ensorceleurs de serpents, consulter cartomancien·nes et assister à tout un « folklore », comme certain·es le formuleraient. À ce titre, j’ai d’ailleurs dans ma collection de diapositives, une catégorie dédiée aux photographies de vacances de personnes blanches parties au Maroc ou en Tunisie, et ayant eu les moyens d’archiver leurs souvenirs. On peut voir sur l’une des diapositives des femmes faisant la danse du ventre dans un grand chapiteau. Ce qui m’intéresse là-dedans, c’est de savoir comment un imaginaire qui n’existe pas se crée malgré tout. Me demander comment jouer de ces codes pour se les approprier et ne plus le subir me fascine.

Quand j’étudiais à la Villa Arson il y a quelques années, j’ai découvert un restaurant nommé « Couscous chez Michel ». Le nom a déjà quelque chose de singulier… Quand on rentrait à l’intérieur de ce restaurant, on pouvait y découvrir une une centaine de cadres accrochés aux murs. Il s’agissait de des collages où l’on peut voir des hommes et des femmes maghrébin·es dans des oasis, sous les palmiers.

La personne qui a créé ce décor a découpé ces images, les a collées, puis ornementées de paillettes pour certaines, de pierre colorées, pour d’autres. Toutes ces archives étaient incroyables. J’ai pris chaque image encadrée en photo. Mais ce processus fut très laborieux car les images étaient sous une vitrine et les photographies étaient par conséquent pleines de reflets. L’appareil photo, n’est pas un outil de travail que j’utilise beaucoup. Je le trouve lourd et contraignant. Je me suis donc dit qu’il fallait que je trouve un moyen furtif, et beaucoup plus efficace de réunir tous ces fragments-là, car ce que j’aime dans ma pratique, c’est le fait de faire vite, de pouvoir récupérer des archives, des fragments dans la rue un peu partout, très rapidement, sans avoir à supporter dans mon sac et ma valise des dizaines de kilos.
CRR : Jusqu’au jour où tu es tombée sur un merveilleux outil…
KEK : J’ai découvert un objet incroyable : le scanner portable. Je l’ai trouvé à force de visiter un grand nombre de sites internet destinés aux objets qui permettent d’archiver C’est un objet qui rentre dans ma poche et que je peux emporter partout. Ce que j’ai fait, c’est le détourner de sa fonction première qui est de scanner des papiers administratifs. J’utilise cet outil dans un but créatif et non pas bureautique. Désormais, je peux scanner des surfaces places : des tables, des murs, des sols. Cet outil m’a permis de ne plus utiliser d’appareil photo et a pris beaucoup de sens dans ma pratique : je glane des images, et la qualité de ces dernières n’est pas du tout ce que je recherche. Il m’importe peu que des image soient authentiques, soient des photocopies, ou des images trouvées sur internet. Le scanner m’a permis de continuer ce que j’avais commencé à faire dans le restaurant « Couscous chez Michel » : aller dans les restaurants et les cafés arabes pour scanner et créer un répertoire de toutes les images utilisées dans ces lieux.
CRR : Qu’est-ce que les images que tu as récoltées disent de ces lieux ?
KEK : Ces images ne sont pas prises au hasard. Elles participent à des mises en scène, à l’image d’un décor de théâtre ou de cinéma, au sein duquel on retrouverait des objets et accessoires permettant de créer une ambiance satisfaisant une certaine catégorie de personnes. Dans ces lieux, on retrouve d’un côté des client·es ayant envie de manger un couscous et un tajine, mais pas seulement. Iels veulent entrer dans un lieu qui les fasse voyager au Maroc, pendant une demie-heure ou une heure. Dans ces lieux, on retrouve une certaine palette de couleurs, des images de palmiers, etc. Les gens sont heureux de se croire au Maroc, ou pour le dire plus justement, dans le Maroc qu’iels fantasment. De l’autre côté, j’observe comment les restaurateur·ices comprennent que les gens veulent de l’exotisme et se mettent à jouer de ces clichés, qu’iels ne subissent plus, car iels se les réapproprient.
Pour moi, il s’agit d’une mise en scène d’un spectacle. Aller manger un couscous ou un tajine dans un restaurant avec une décoration épurée, décevra les gens. Le scanner portable me permet d’aller de restaurant en restaurant, et de réaliser un répertoire sans fin que j’ai envie d’enrichir par des images capturées dans plusieurs villes, grâce à cet outil, mais également en prenant des cartes de visites, ou des photos avec mon téléphone. Lorsqu’on crée un film on repère des décors, des accessoires, des lieux pour coller à un scénario. Moi je n’ai pas de scénario, mais je fais tout un travail de repérage de lieux dont je rends ensuite compte en extrayant les visuels de leur contexte et en les rangeant dans des classeurs pour ne plus avoir que le visuel et analyser ce qu’il raconte. J’archive les fragments que je récolte et que je classe. Cela me permet d’associer certains éléments avec d’autres, de réfléchir à des manières de les montrer ensemble, ou non. Je crée des passerelle entre des récits et des formes.