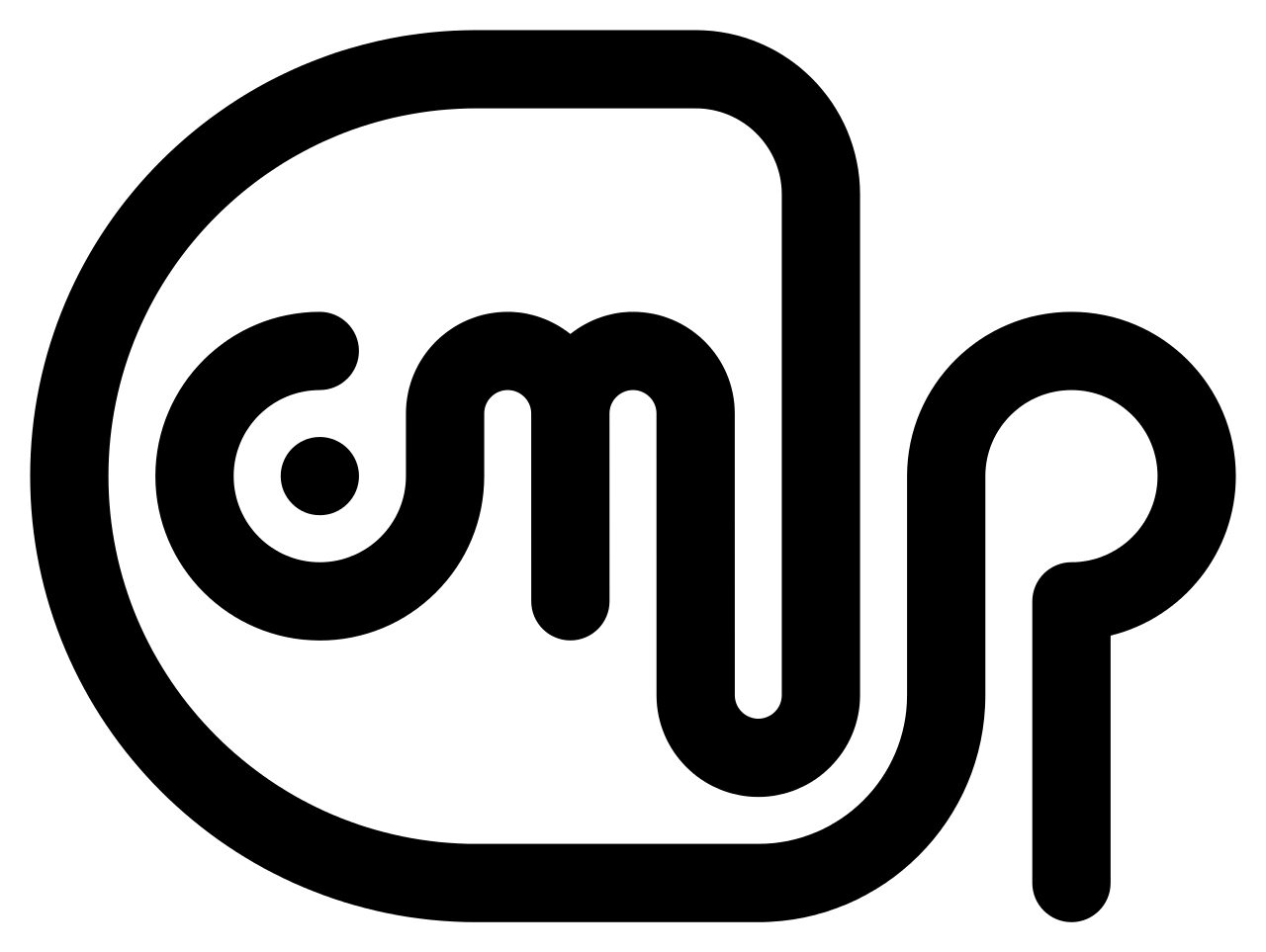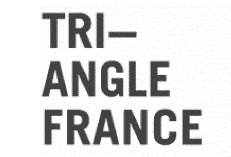Commun.e - Q&A
Conçu par l'artiste et curatrice Ziphozenkosi Dayile, Commun.e examine l'importance des savoirs locaux et des pratiques de soins collectives dans les processus de décolonisation. C'est une invitation à l’échange et à la production de savoirs communs, fondée sur la rencontre et la multiplicité des points de vue. Ainsi, le programme se déroule sur plusieurs sessions qui prennent la forme d'événements physiques, tout au long de l'été 2021 à Marseille et Cape Town, et de restitutions en ligne, sur Bruise Magazine.

A la suite des différentes interventions, Eden Tinto-Collins, Vir Andrès Hera, Buhlebezwe Siwani et Belinda Zhawi ont échangé avec les curatrices et le public, autour de leurs pratiques respectives, des origines de leurs travails et du rôle de la communauté.
Ziphozenkosi Dayile : Lorsque je travaille en collaboration avec d’autres personnes, je ressens une telle motivation que souvent je m’embarque dans des projets à long terme. Ma motivation vient des gens qui m'entourent et je me demandais si c’était également votre cas, Eden, Vir Andrès ? De quoi partent les conversations et les collaborations dans lesquelles vous vous lancez ?
Vir Andrès Hera : Pour répondre brièvement je vais citer Emilie Notéris et son livre Alma Matériau. C’est une autrice française qui s’intéresse aux différents types de féminismes et qui travaille autour du concept d’Audre Lorde, « how to mother ourselves? ». Pour moi, œuvrer au sein de Qalqalah c’est un peu ça, c’est se choisir pour se guider dans une certaine direction. La dimension affective est importante pour créer ces relations, pour donner du temps, de l’énergie, s’impliquer dans un travail et prendre soin des personnes que l’on invite.
Eden Tinto-Collins : Dans la plupart des collectifs avec lesquels je travaille, que cela soit le groupe musical Gystère, le projet Black(s) to the Future ou même Yoke, la dimension artistique est en fait très liée à la vie. Il faut passer du temps ensemble, manger, prendre soin les un•es des autres. La notion de care, aujourd’hui très à la mode, montre aussi à quel point il est important, maintenant, de travailler dans cette énergie collective et de la démultiplier.
Hier soir, avec Flora et Zipho, nous parlions du réseau et du rhizome : ce sont deux notions qui sont aujourd’hui très théorisées, très académiques mais qui, pourtant, font écho à une réalité très simple. Avec internet, notamment, on est dans une exploration permanente. Peut-être qu’on ne la mène pas en pleine conscience avec un bagage théorique et référentiel super fort, mais je pense que c’est vraiment le nouveau jeu auquel on est convié, celui de scroller avec les pouces. Cette circulation s’active aussi beaucoup via les mots qui sont aujourd’hui à la mode : la fluidité, l’hydro-féminisme, et ce genre de terminologie - de terminal puisque c’est aussi une façon de décoller vers de nouveaux espaces, ouvrent de nouveaux horizons. C’est quelque chose que j’aimerais explorer cet été.
Du coup j’ai envie de poser une question : j’imagine qu’il y a d’autres praticien•nes aujourd’hui, des personnes sensibles à cette énergie collective. Je me demandais si l’eau était (parce qu’à Marseille c’est quand même hyper important) un élément que vous mobilisiez pour penser ces notions de fluidité, de rapport au groupe.
Première personne du public : J’ai une pratique artistique et j’habite à Marseille depuis deux ans. Je pense que le rapport à l’eau est quelque chose de très présent ici et que je vois souvent apparaître, tout comme celui au paysage. Dans ma pratique le rapport à la mer est important : par exemple j’ai réalisé une exposition il y a quelques mois dans laquelle j’ai collecté de l’eau de mer au Mont Rose, qui est un lieu de cruising gay à Marseille, et que j’ai déversé dans tout l’espace d’exposition et sur plusieurs surfaces. Après il y avait tout un travail avec la cristallisation du sel, etc. Cette notion de l’eau comme quelque chose qui se déverse, qui peut passer d’un contenant à un autre, c’est quelque chose qui apparaît assez clairement dans cette ville.
Deuxième personne du public : Bonjour, je suis aussi praticien. Pour répondre à ta question je pense que l’eau est très importante à Marseille, notamment sur le plan politique. C’est une des villes où il y a le moins d’enfants qui savent nager en France, alors qu’il y a un accès à la mer quotidien. Il y a très peu de piscines municipales ou facilement accessibles. Par rapport aux industries et à la pollution, l’eau est quelque chose de très particulier. Ceci étant dit, je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans cette idée de « fluidité », de « liquide » comme tu disais, et je pense que cela peut toucher énormément de thématiques.
Marie-Rose, troisième personne du public : Bonjour, je m’appelle Marie-Rose, je suis artiste et depuis peu je travaille avec la population afro-descendante parce que je me suis rendue compte qu’il n’y avait pas réellement de Marseillais•es noir•es.
Je me suis rendue compte que l’eau avait un grand lien important avec la population noire à Marseille. En effet, après la Seconde Guerre mondiale beaucoup de tirailleurs sénégalais qui étaient arrivés par bateau sont restés à quai car ils ne pouvaient pas embarquer. Il y a toute une tradition, une culture, qui s’est constituée autour du port de Marseille, avec les dockers noirs notamment. Cela a très bien été documenté par Ousmane Sembène dans Le docker noir.
Ife, Quatrième personne du public : Bonjour, merci pour tout, merci pour vos présentations, c’était vraiment très fort et généreux, merci pour cette plongée. Je suis nomade, je m’appelle Ife et je suis artiste performeuse. J’ai débarqué à Toulon puis suis venue à Marseille mais, depuis novembre je suis bloquée ici à cause du confinement. Du coup, mon premier réflexe a été de trouver la mer. Étant loin des mères et des sœurs qui ont toujours été autour de moi, mon premier réflexe a été de chercher la mer. La mer, comme le sel de mer, procure cette proximité, cette matière qui soigne et protège.

Cinquième personne du public : Bonjour, moi je suis à Marseille mais je ne travaille pas beaucoup sur la mer. J’aurais aimé savoir comment vous fonctionnez avec vos différents collectifs et si vous pouviez nous raconter comment vous avez rencontré•es les différentes personnes avec lesquelles vous travaillez? Comment intégrez-vous cette fluidité à votre travail ? Comment intègre et quitte -t-on un collectif?
Vir Andrès Hera : D’abord, il ne faut pas oublier que Qalqalah c’est un collectif qui marche dans une économie fragile car en tant que travailleurs et travailleuses de l’art, on n’a pas tous•tes des revenus fixes. Moi, par exemple, je suis artiste donc mes revenus sont plus ou moins stables, voire faibles. Certain.e.s ont des activités plus encadrées donc chacun•e travaille en fonction du temps qu’iel peut apporter. On n’est pas du tout dans un rapport de business autour de projet, on ne génère pas d’argent. Par exemple, les invitations que les écoles ou les institutions nous font nous permettent juste de pouvoir continuer à faire rouler la machine. Dès que l’on a un peu d’argent, on l’utilise pour inviter d’autres artistes, pour payer la maintenance de la plateforme, etc. C’est plus ou moins complexe et il nous semble important de rappeler cette réalité, qui a un impact sur la façon dont on peut mener les projets. Par exemple, il peut se passer trois mois comme un an, entre le moment où on lance une invitation et celui où l’on peut traduire de l’arabe au français ou à l’anglais.
Eden Tinto-Collins : C’est juste. Pour ma part je suis plutôt basée à Paris et l’activité artistique avant l’épidémie Covid-19 était beaucoup plus intense. Il y avait des lieux pour se rencontrer entre personnes intéressées par l’art et sa pratique et c’est dans un espace qui a fermé, la Villa Vassilieff, que l’on s’est rencontrées avec Mawena Yehouessi, la fondatrice du collectif Black(s) to the Future. Depuis cette rencontre, on a vraiment créé un vocabulaire commun, une nouvelle langue pour évoquer les questions qui nous tenaient à cœur et la notion d’inclusivité. Nous n’avions pas ce mot à l’esprit donc nous mettions des points, des tirets entre les mots parce qu’on s’apercevait qu’en termes de sons, ça permettait d’entendre plusieurs choses. Assez souvent il y avait quelque chose de l’ordre du jeu de mots qui était un peu le vocabulaire des publicitaires mais qui poétiquement nous donnait une ouverture et nous permettait de respirer. Grâce à ça, grâce à Mawena, je me suis mise à écrire et j’ai publié Bonne arrivée dont j’ai lu un extrait. La question qui s’est ensuite posée c’était comment alimenter cette énergie : j’étais étudiante aux Beaux Arts de Cergy à l’époque, avec une économie et une écologie très vulnérables parce que je travaillais à côté. Il fallait vraiment se blinder et engager son énergie vitale pour pouvoir être partout avec envergure. C’était compliqué mais on a beaucoup échangé, on a créé beaucoup de rencontres. Parmi elles Tarek Lakhrissi, Kengné Téguia, Josefa Ntjam, Fallon Mayanja, Nadir Khanfour... et on est de plus en plus à se parler.
Un de nos enjeux est l’accès aux espaces : les institutions, malgré leur pouvoir et les ressources dont elles disposent, tendent à inviter davantage les individus que les groupes, ce qui rend difficile l’organisation d’événements pour nous. Même si ça a contribué à nous dispersé•es, en mon fort je crois vraiment qu’on continue à travailler ensemble ; ensemble mais séparément. Parce que le vocabulaire et le temps que l’on a passé tous•tes ensemble dans des conditions très très dures on ne pourra jamais l’oublier. Donc ça continue et c’est une aventure qui prend d’autres formes et qui moi m’a permise aussi d’explorer quelque chose que je ne faisais pas avant, comme la musique.
Merci à toutes et tous pour vos témoignages sur l’eau, c’était vraiment très fort.
**

Flora Fettah : Moesha, merci pour cette performance. C’est vraiment génial de pouvoir partager ce moment avec toi, puis d’avoir la possibilité de parler ensemble de ta pratique. Je l’ai découverte lors de fêtes, qui sont des moments intenses et forts en émotions, mais pas toujours propices aux échanges de fond. Commun.e se veut un moment de mise en commun et de partage des ressources, notamment au travers des pratiques collectives. Le travail de DJ et performeur.se peut paraître un peu solitaire mais j’ai l’impression que toi, tu collabores souvent avec d’autres musicien.ne.s ou avec des artistes issu.e.s d'autres champs des arts?
Moesha 13 : Bonsoir. Je voudrais d’abord remercier toutes les personnes présentes car j’ai ressenti une énergie incroyable et c’était vraiment magnifique. Malgré les contraintes techniques, le fait que les gens soient obligés d’être assis, l’échange n’a pas été limité. Donc merci.
Effectivement je collabore beaucoup avec des artistes qui ne sont pas forcément dans le même domaine que moi, ou qui ne se trouvent pas forcément dans le même pays que moi. Internet permet d’avoir des échanges de manière assez fluide, sans limites ou de barrières. Dans ma musique, avec mon oreille, je mets aussi en lien des choses apparemment éloignées. Pour moi elles font sens et c’est un moyen d’exprimer des choses auxquelles on ne laisse pas la place. J'utilise beaucoup de médias différents pour créer des documents sonores qui parlent de post-colonialisme. Je les compose à partir de documentations archivées sur internet que je trouve sur des sites précis. Ils s’approchent plus de la dissertation philosophique que du DJ set finalement.
Tout à l’heure tu disais que je faisais beaucoup de DJ sets et c’est vrai, mais ce qui est un peu triste comme constat c’est qu’on ne laisse pas souvent la place au DJ d’exprimer autre chose que du fun et il est difficile de porter un message. Ce soir c’est différent et je suis heureux.se de pouvoir exprimer certains messages face à un public et pas forcément via le média Mixtape.
Ziphozenkosi Dayile : Avant d’arriver en résidence ici, j’avais hâte de travailler avec des artistes et des collectifs de Marseille et de France. Mais on m’a beaucoup dit que je ne pourrais pas parler d’identités et des politiques en la matière, surtout concernant la condition noire puisque la France se veut une Nation indivisible : il n’y a pas de noir, pas de blanc, pas de couelur. Ce qui pour moi veut dire qu’il n’y a pas de véritable Histoire. Donc entendre des artistes, dans un lieu comme celui-ci, parler, se positionner, exprimer leur identité et dire qui iels sont, je trouve ça assez incroyable. Cette idée d’unité et d’identité française univoque m’angoisse et je me demande comment les choses se passent pour les personnes qui travaillent ici. Moesha, as-tu l’impression qu’il s’agit d’une oppression à ton encontre ? As-tu l’impression de seulement exister dans les marges ? Ou est-ce que tout ça est faux et que l’on m’a menti ?
Moesha 13 : Merci pour cette question, parce que là on évoque un passé douloureux. Tu sais que la France a du mal à regarder en face son histoire coloniale, ce qui fait que dès le départ on n’a pas une éducation complète. L’Histoire est entachée, on a finalement accès à un centième de celle-ci. On apprend l’Histoire des Français.e.s, mais on n’apprend pas notre Histoire. On grandit sans Histoire. A force de se confronter aux murs d’un silence perçant, une sorte de résilience, une résistance naît au fond de nous. Ce n’est pas un choix, c’est un devoir.
Depuis maintenant quelques années, des communautés noires se forment mais ce n’est pas simple ; elles vont très souvent être récupérées et "exotisées". Une idée de départ intéressante va être récupérée par des personnes qui ont des intérêts, qui peuvent se faire de l’argent dessus. Rester uni.e.s est difficile, on apprend aux gens à être les uns contre les autres et pas forcément les uns avec les autres. On nous dit que notre devise est censée être « liberté, égalité, fraternité », mais c’est plutôt « diviser pour mieux régner ». Les artistes et communautés noires qui parviennent à rester fortes sont celles qui n’ont pas d’autre but que de dire la vérité et se réunir.
J’ai cru, et je prône le fait que l’on soit chez nous, mais en fait, il y a le discours et il y a la réalité. Il y a la théorie et ce que la diaspora vit au quotidien. C’est un parcours du combattant tous les jours : tu peux par exemple faire des expositions, penser que tout le monde est ensemble, que tout le monde contribue, cependant il y a toujours un moment où tu vas rencontrer une personne qui va te rappeler que tu es noir•e.
Ziphozenkosi Dayile : Merci. Ce que tu dis est familier et résonne avec nos expériences sud-africaines, notamment parce que l’apartheid s’est assurée de nous diviser pour que nous soyons toujours le peuple qui se bat pour des miettes et pas pour les vraies choses. ça fait aussi écho avec le monde de l’art et la façon dont les personnes, précarisées, se battent pour les restes mais pas pour le steak.
Je pense que c’est ce que Buhlebezwe et Dorothée ont exprimé dans leur performance. Elles ont trouvé le moyen de lier leurs récits personnels et les Histoires de leurs pays respectifs pour créer une œuvre qui montre que les contes sur la différence que l’on promeut, ne sont pas réels et on ne peut y aspirer. Ces histoires ne permettront pas de construire des communautés et des sociétés meilleures. Il faut commencer par regarder ce que l’on a en commun, et construire à partir de là.
La performance présentée aujourd’hui était en grande partie improvisée : Dorothée et Buhlbezwe n’avaient jamais travaillé ensemble avant. J’ai voulu les rassembler pour cette session car, en regardant leurs travaux précédents, je me suis dit qu’elles pourraient se parler. Peut-être Buhlebezwe, peux- tu parler de ton expérience de travail avec Dorothée et de la façon dont vos passés vous ont permis de créer ensemble cette performance?
Buhlebezwe Siwani : Je ne connaissais pas le travail de Dorothée car elle est danseuse-chorégraphe et qu’elle travaille beaucoup avec le son alors que mon travail est plus visuel et performatif, d’une façon très différente. Lorsqu’elle m’a invitée, Zipho avait exprimé son intérêt de voir comment nous pourrions travailler ensemble et parvenir à une œuvre commune, puisque le son m’importe et que Dorothée en utilise un grand nombre. Je suis arrivée lundi à Marseille et j’ai rencontré Dorothée le lendemain. Pendant une heure et demie nous avons déjeuné et discuté de là d’où nous venions, de ce qui nous intéresse. Je lui ai parlé de l’Afrique du sud, de la colonisation et elle m’a parlé du génocide rwandais. La chose que nous avions en commun était l’idée du sang et de la nourriture, de la terre qui est presque une mine de corps, un gisement de nourriture qui gardent nos corps en vie alors même qu’elle est pleine de corps enterrés. De là, une idée est née. Puis nous avons parlé des politiques mises en œuvre dans nos pays d’origine, de ce que nous ressentons de venir de là-bas et ce que nous ressentons en étant ici. Nous étions d’accord qu’il était important d’organiser un dîner cauchemardesque. Il y avait plusieurs contraintes du fait d’être dans un musée en temps de Covid et notamment de ne pouvoir y manger. Le cauchemar vient de là : vous êtes face à une belle table sur laquelle se trouve de la nourriture, que vous pouvez sentir, que vous pouvez presque toucher mais que vous ne pouvez pas manger. Dans le même temps, quelqu’un.e bave et danse devant vous. Toutes ces choses sont des indices que quelque chose ne va pas, dysfonctionne et est malade. C’est là que nous en sommes venues, et nous nous sommes nourries mutuellement de nos énergies.
Guslagie, sixième personne du public : Moesha, j’ai une question au sujet de ton rapport à l’archive. Je te suis sur instagram, j’ai eu l’occasion de t’écouter une fois mais c’est la première fois que je te vois performer et t’entends parler. C’est intéressant car le Covid et les masques et le fait qu’on soit assis permet d’écouter vraiment ta partition. Et je trouve que pour quelqu’un qui se considère comme DJ, artiste ou performeuse, c’est toujours très intéressant quand on est obligé d’écouter, qu’on est pas dans une ambiance night. Ton rapport à l’archive c’est ce que j’ai noté très vite lorsque j’ai découvert ton travail. Je voudrais savoir comment tu fabriques ces archives, comment tu les agences entre elles pour leur donner du sens. Chaque archive arrive à un moment entre deux musiques : soit populaire, soit on sent que tu es allée fouiller dans la mémoire africaine. Je voulais voir comment tu travailles ce scénario.
Moesha 13 : Cette question est un peu au cœur de ma problématique. J’ai fait un master de philosophie, j’ai un rapport important à la lecture et à la recherche. Au départ, pour moi, il y avait deux mondes : le monde des lecteur.rice.s, des gens qui recherchent le savoir et le mien, celui de la culture populaire. La base de ma pratique était de traduire les lectures que je faisais afin de les rendre compréhensibles aux personnes de mon quartier ; comment extraire le message et le partager.
J’ai commencé par utiliser plusieurs médias différents, mais très souvent je me suis servie de la culture populaire pour pouvoir faire passer des messages que tout le monde serait à même de pouvoir comprendre. Me sentant un peu limité.e, les documents sonores m’ont beaucoup aidée car j’ai pu lire des pages et en y ajoutant des fonds sonores. Parfois il s’agit juste de passer des musiques qui viennent de tel endroit, mais là ce qui est intéressant ce n’est pas forcément le message, c’est juste le fait que ça existe à cet endroit, qu’il y ait une connexion. Parfois c’est juste des Africain.e.s qui prônent l’amour, c’est simple, mais universel. Après dans ma propre pratique de performance, j’ai beaucoup voyagé dans des pays de l’Est car ce qui m’intéressait c’était la rencontre, voir comment la musique s’exporte, comment l’échange se passe dans le réel.
Septième personne du public : Et comment choisis-tu quand finir ta partition ? Là, tu as terminé avec un texte que tu nous as lu, qui revient sur ce terme de « commun.e », mais comment finis-tu en musique ? Car ça pourrait être sans fin, notamment quand on aime les archives.
Moesha 13 : Pour répondre à ta question, il faut contextualiser : en général, je fais des œuvres in situ. Hier je suis venue ici pour m’imprégner du lieu, pour sentir les énergies, discuter avec chaque personne. La somme de cette recherche a tracé le squelette de la performance. Puis, pendant mon live, pas mal d'éléments se sont ajoutés et les énergies ont à nouveau circulé. Je travaille beaucoup avec la circulation, suivant un schéma qui s’approche des questions/réponses. Je peux terminer au moment où j’ai pris des risques et où je me suis suffisamment mis à nu.
Flora Fettah : J’aimerais maintenant m’adresser à Belinda et que l’on parle de la façon dont tu composes tes pièces. Tu utilises ta voix, tes mots, mais aussi des extraits sonores que tu insères, comme dans la pièce que tu as partagé avec nous aujourd’hui.
Belinda Zhawi : Merci. Les quinze premières minutes de cette performance étaient une pièce South x South East qui tente de faire le lien entre différents endroits que j’appelle chez moi. Il s’agit du Sud-Est de l’Afrique, notamment le Zimbabwe, et le le Sud-Est de Londres, au Royaume-Uni. J’ai beaucoup aimé ce processus d’assemblage qui est central dans la façon dont j’écris des poèmes : je compile un maximum de choses puis j’en enlève pour ne laisser que ce qui est nécessaire. La plupart des sons que j’insère sont des enregistrements réalisés dans certaines parties du Zimbabwe, comme Harare, où j’ai grandi, mais aussi dans les transports en commun de Londres. Il s’y passe plein de choses quelque soit l’heure et l’endroit, notamment parce que Londres est une ville passionnante, composée d’un très grand nombre de cultures, de gens qui viennent de partout, et surtout du continent africain. C’est une ville très diverse, mais c’est aussi une ville ségréguée. Je voulais capturer ces sons dans des lieux différents et les comparer. Une grande partie d’entre eux ont été enregistrés tôt le matin. C’est le moment où tu ne vois presque que des personnes qui me ressemblent dans les transports communs car ce sont elles qui nettoient les bureaux avant que les gens arrivent à 9 heures. Ce sont ces existences silencieuses qui permettent à la ville de fonctionner. Ceci étant dit, il s’agit d’un travail assez personnel autour des connexions que je fais entre deux endroits, entre deux géographies. Je me rappelle que lorsque j’ai déménagé dans le Sud-Est de Londres, je me sentais très Zimbabwéenne et je disais souvent “Je viens du Zimbabwe”, ce qui est le refrain du poème : “ I come from, I come from, I come from…”. J’ai vécu au Royaume-Uni sans papier, de façon très précaire et ce pendant des années, en ayant l’impression de ne pas appartenir à cet endroit ; puis de retourner au Zimbabwe et développer une nouvelle compréhension de mon identité zimbabwéenne, celle d’une personne qui est partie depuis longtemps. J’ai finalement réussi à donner du sens au fait que je viens de deux endroits, qu’ils sont tous deux ma maison : j’ai passé une grosse partie de mes premières années à mener une vie très zimbabwéenne mais le Sud-Est de Londres m’a doté d’un langage que j’utilise pour m’exprimer. D’un coup, j’ai dû vivre dans cette double conscience : comment se comporter dans des espaces formels et parler un anglais standard tout en vivant et survivant dans le sud de Londres en parlant un autre langage, celui que la plupart des gens y parle, marqué par les patois caribéens et ouest-africain. C’est ces idées que je voulais explorer dans cette œuvre.
La seconde, qui suit, traite des origines et joue avec les sons, floute les mots, met un peu la pagaille car c’est ce qu’est le langage pour moi : prendre ce qui était là avant nous et jouer avec.
Huitième personne du public : Je voulais revenir sur ce que vous disiez, sur le fait qu’en France il y avait cette sorte de nuage transparent qui ne permet généralement pas d’avoir les discussions que nous avons actuellement, surtout dans des lieux aussi grands et aussi vocaux que celui-ci. Je voulais donc vous remercier pour cette discussion.
Moesha 13 : Merci de le relever car parfois on a un peu le sentiment d’être seul.e. Et le fait de mettre des mots dessus, de créer des espaces, ça ouvre la voie, d’autres personnes se mettent à parler et on se rend finalement compte que l'on vienne du Zimbabwe, du Mali, d’Afrique du Sud, ou autre, que ces problématiques nous sont communes. On arrive à toustes parler et à communiquer et c’est ça qui nous rend plus fort.e.s.
Neuvième personne du public : Je voulais poser une question à Eden Tinto Collins par rapport aux archives. Tout à l’heure tu nous parlais de ton projet, de sa naissance grâce à une personne qui fait sa thèse sur des archives afro-futuristes, et je voulais en savoir plus.
Eden Tinto-Collins : Merci pour cette question. Je suis heureuse de vous retrouver toutes à ce moment de la discussion. Au courant de la journée beaucoup de ces concepts d’archives, de comment travailler la mémoire et échanger des savoirs ont été partagés.
Le projet dont tu parles s’appelle Black(s) to the Future et a été initié par Mawena Yehouessi qui est en ce moment en thèse sur ce sujet là, à Nice. Elle va la restituer au travers d’un film, fruit d’un travail collectif. Pour faire un film il faut créer une histoire, donc écrire, appeler des personnes qui sont des créateur.rice.s et deviennent des co-créateur.rice.s. Il y a une énergie presque tentaculaire qui se déploie entre toutes les personnes qu’elle appelle et qu’elle réunit. Ce travail est venu d’un désir de créer un espace d’archives, et ce de façon internationale. Il s’agit aussi de revisiter L’histoire de l’Afrique, qui est visible sur le site de l’UNESCO mais incomplète. Et en se rendant compte de cela, du fait qu’il n’est pas possible d’écrire une histoire complète, comment augmenter la réalité que l’on partage et y avoir toustes accès ? Le silence est devenu insoutenable et il semble nécessaire d’aujourd’hui dire la vérité. On se rend compte que l’art et tous ces moments sociaux font partie de la thérapie : ça fait du bien de se voir, d’échanger, d’avoir des espaces où parler de ces concepts et de les activer en s’éloignant d’une théorie qui peut s’avérer être alourdissante.
Traduction français - anglais : Zahra Tavassoli Zea
Photographies © Grégoire d’Ablon
© Architectes Rudy Ricciotti et Roland Carta / Mucem